Orthographe / vocabulaire
Modérateurs : Magistrats de Jade, Historiens de la Shinri
- Kõjiro
- Gouverneur de province
- Messages : 10092
- Inscription : 12 mai 2002, 23:00
- Localisation : District Hojize
- Contact :
Zones de quarantaine tout simplement non ?
C'est utilisé dans quel cadre ce mot ?
C'est utilisé dans quel cadre ce mot ?

"Les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée. Trop de citoyens veulent la civilisation au rabais" - Henry Morgenthau, remettant son rapport sur l'utilisation abusive des paradis fiscaux par les contribuables au président Roosevelt en 1937.
- Kakita Inigin
- Bureau
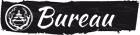
- Messages : 19644
- Inscription : 30 sept. 2004, 15:09
- Localisation : Entre rivière et mine
- Contact :
L'épisto non, ce serait proche de la logique interne à la progression des connaissances.Kyorou a écrit :Donc (pour être sûr de bien cerner le truc) ce serait assez proche de la philosophie de l'esprit ?
La philosophie de l'esprit c'est comment fonctionne l'esprit humain (et qu'est-ce), l'épisto c'est comment fonctionne une discipline.
la gnoséo ... pour moi c'est surtout un joli mot savant ...
un classique ... IDIOSYNCRASIE
IDIOSYNCRASIE, subst. fém.
A. MÉD. Prédisposition particulière de l'organisme qui fait qu'un individu réagit d'une manière personnelle à l'influence des agents extérieurs. Avoir une idiosyncrasie pour le sérum. Les cas où les doses faibles ont pu déterminer des accidents sérieux relèvent de l'idiosyncrasie (VINCENT, RIEUX ds Nouv. Traité Méd., fasc. 5, 1, 1924, p. 200) :
... l'idiosyncrasie est l'aptitude innée que possède un élément organique à manifester plus ou moins facilement l'irritabilité, qui est la manifestation vitale fondamentale. C'est une sorte de sensibilité réelle qui appartient à chaque matière, à chaque élément organique.
C. BERNARD, Princ. méd. exp., 1878, p. 155.
B. Personnalité psychique propre à chaque individu. Nous ne valons que par ce qui nous distingue des autres; l'idiosyncrasie est notre maladie de valeur (GIDE, Paludes, 1895, p. 120). Naguère, alors qu'on n'aimait plus le mot « âme », on le remplaçait par « tempérament » ou « idiosyncrasie » (BOSCHOT, Mus. et vie, 1931, p. II).
C. LING.(empr. à l'angl.). Tendance des sujets à organiser les règles générales de formation des mots d'une même langue de manière différente selon leurs dispositions intellectuelles ou affectives particulières. On envisagera successivement trois types d'« irrégularités » dans le lexique : les idiosyncrasies; les lacunes accidentelles; l'existence de processus non productifs à côté des processus productifs de formation des mots (D. CORBIN, Le Statut des exceptions dans le lexique ds Lang. fr., 1976, no 30, p. 90).
REM. Idiosyncratique, adj. Particulier. Ces rapports semblent exclusivement affectés à certains tempéramens, ou même à certains individus : ils constituent alors les sympathies idiosyncratiques ou particulières (CABANIS, Rapp. phys. et mor., t. 2, 1808, p. 411).
Prononc. et Orth. : []. Att. ds Ac. dep. 1878. Étymol. et Hist. 1581 (NENCEL, Disc. très ample de la peste, P. Méd., 58, 934 ds QUEM. DDL t. 3). Empr. au gr. « tempérament particulier ». Fréq. abs. littér. : 38.
DÉR. Idiosyncrasique, adj. Relatif à l'idiosyncrasie. Son aversion des prêtres était idiosyncrasique (HUGO, Travaill. mer, 1866, p. 118). Chaque diabétique a « son équation idiosyncrasique pour chaque aliment glycogénique en particulier » (BOUCHARDAT ap. LE GENDRE ds Nouv. Traité Méd., fasc. 7, 1924, p. 471). []. 1re attest. 1832 (RAYMOND); du rad. de idiosyncrasie, suff. -ique*. Fréq. abs. littér. : 15.
BBG. QUEM. DDL t. 7 (s.v. idiosyncratique).
IDIOSYNCRASIE, subst. fém.
A. MÉD. Prédisposition particulière de l'organisme qui fait qu'un individu réagit d'une manière personnelle à l'influence des agents extérieurs. Avoir une idiosyncrasie pour le sérum. Les cas où les doses faibles ont pu déterminer des accidents sérieux relèvent de l'idiosyncrasie (VINCENT, RIEUX ds Nouv. Traité Méd., fasc. 5, 1, 1924, p. 200) :
... l'idiosyncrasie est l'aptitude innée que possède un élément organique à manifester plus ou moins facilement l'irritabilité, qui est la manifestation vitale fondamentale. C'est une sorte de sensibilité réelle qui appartient à chaque matière, à chaque élément organique.
C. BERNARD, Princ. méd. exp., 1878, p. 155.
B. Personnalité psychique propre à chaque individu. Nous ne valons que par ce qui nous distingue des autres; l'idiosyncrasie est notre maladie de valeur (GIDE, Paludes, 1895, p. 120). Naguère, alors qu'on n'aimait plus le mot « âme », on le remplaçait par « tempérament » ou « idiosyncrasie » (BOSCHOT, Mus. et vie, 1931, p. II).
C. LING.(empr. à l'angl.). Tendance des sujets à organiser les règles générales de formation des mots d'une même langue de manière différente selon leurs dispositions intellectuelles ou affectives particulières. On envisagera successivement trois types d'« irrégularités » dans le lexique : les idiosyncrasies; les lacunes accidentelles; l'existence de processus non productifs à côté des processus productifs de formation des mots (D. CORBIN, Le Statut des exceptions dans le lexique ds Lang. fr., 1976, no 30, p. 90).
REM. Idiosyncratique, adj. Particulier. Ces rapports semblent exclusivement affectés à certains tempéramens, ou même à certains individus : ils constituent alors les sympathies idiosyncratiques ou particulières (CABANIS, Rapp. phys. et mor., t. 2, 1808, p. 411).
Prononc. et Orth. : []. Att. ds Ac. dep. 1878. Étymol. et Hist. 1581 (NENCEL, Disc. très ample de la peste, P. Méd., 58, 934 ds QUEM. DDL t. 3). Empr. au gr. « tempérament particulier ». Fréq. abs. littér. : 38.
DÉR. Idiosyncrasique, adj. Relatif à l'idiosyncrasie. Son aversion des prêtres était idiosyncrasique (HUGO, Travaill. mer, 1866, p. 118). Chaque diabétique a « son équation idiosyncrasique pour chaque aliment glycogénique en particulier » (BOUCHARDAT ap. LE GENDRE ds Nouv. Traité Méd., fasc. 7, 1924, p. 471). []. 1re attest. 1832 (RAYMOND); du rad. de idiosyncrasie, suff. -ique*. Fréq. abs. littér. : 15.
BBG. QUEM. DDL t. 7 (s.v. idiosyncratique).
ÉPIGONE, subst. masc.
A. MYTH. Chacun des héros grecs de la seconde expédition contre Thèbes, fils et vengeurs des sept chefs qui avaient péri au cours de la première guerre.
B. P. ext. et souvent péj. Successeur (souvent un peu original) dans un parti, une école littéraire ou philosophique. Il ne put se défendre d'un geste agacé, comme s'il balayait, d'un revers de main, tous ses successeurs, et il prononça : Ces épigones! (DRUON, Gdes fam., t. 1, 1948, p. 44). Cependant la postérité spirituelle de Wagner est innombrable, et durant plus de trente ans, ses épigones ont imité le Maître (DUMESNIL, Hist. théâtre lyr., 1953, p. 168).
Prononc. et Orth. : []. Var. [-go:n] corresp. à la prononc. ancienne des mots en -one ds BARBEAU-RODHE 1930. Le mot est enregistré au plur. ds GATTEL 1841. Étymol. et Hist. 1. 1752 myth. gr. (Trév.); 2. 1876, 17 août fig. (SCHERER, Le Temps, p. 3, col. 4 ds LITTRÉ Suppl.). Empr. au gr. (d'où lat. class. Epigoni) littéralement « né après, descendant », « les Épigones, les descendants des sept chefs tués devant Thèbes ». Fréq. abs. littér. : 9.
Dans le contexte :
[...] séduit par l'apport, selon lui fondamental, de Say et de ses épigones à l'analyse économique, il souhaite cependant tempérer [...]
A. MYTH. Chacun des héros grecs de la seconde expédition contre Thèbes, fils et vengeurs des sept chefs qui avaient péri au cours de la première guerre.
B. P. ext. et souvent péj. Successeur (souvent un peu original) dans un parti, une école littéraire ou philosophique. Il ne put se défendre d'un geste agacé, comme s'il balayait, d'un revers de main, tous ses successeurs, et il prononça : Ces épigones! (DRUON, Gdes fam., t. 1, 1948, p. 44). Cependant la postérité spirituelle de Wagner est innombrable, et durant plus de trente ans, ses épigones ont imité le Maître (DUMESNIL, Hist. théâtre lyr., 1953, p. 168).
Prononc. et Orth. : []. Var. [-go:n] corresp. à la prononc. ancienne des mots en -one ds BARBEAU-RODHE 1930. Le mot est enregistré au plur. ds GATTEL 1841. Étymol. et Hist. 1. 1752 myth. gr. (Trév.); 2. 1876, 17 août fig. (SCHERER, Le Temps, p. 3, col. 4 ds LITTRÉ Suppl.). Empr. au gr. (d'où lat. class. Epigoni) littéralement « né après, descendant », « les Épigones, les descendants des sept chefs tués devant Thèbes ». Fréq. abs. littér. : 9.
Dans le contexte :
[...] séduit par l'apport, selon lui fondamental, de Say et de ses épigones à l'analyse économique, il souhaite cependant tempérer [...]
- Kakita Inigin
- Bureau
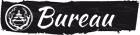
- Messages : 19644
- Inscription : 30 sept. 2004, 15:09
- Localisation : Entre rivière et mine
- Contact :
- Kõjiro
- Gouverneur de province
- Messages : 10092
- Inscription : 12 mai 2002, 23:00
- Localisation : District Hojize
- Contact :
Idem qu'Inigin.
La fonction logique OU inclue bien le ET mais je doute que quiconque interprète un ou dans un texte comme un et/ou...
Donc moi je continuerais (et je le fais parfois) à mettre et/ou.
La fonction logique OU inclue bien le ET mais je doute que quiconque interprète un ou dans un texte comme un et/ou...
Donc moi je continuerais (et je le fais parfois) à mettre et/ou.

"Les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée. Trop de citoyens veulent la civilisation au rabais" - Henry Morgenthau, remettant son rapport sur l'utilisation abusive des paradis fiscaux par les contribuables au président Roosevelt en 1937.
-
Hida Matsuura





